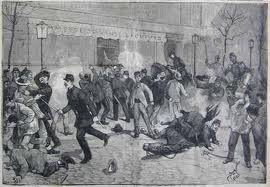Portrait noir et blanc de Camille Buffardel,
industriel et adjoint au maire de Die, résistant du réseau Buckmaster Roger.
Camille Buffardel a été exécuté par la Milice le 23 juillet 1944 à Die.
Camille Buffardel a été exécuté par la Milice le 23 juillet 1944 à Die.
La Milice impitoyable
contre la Résistance, investit des villages et prend des otages. C’est
pratiquement toujours à la suite de dénonciation, ou avec l’aide de miliciens
infiltrés dans la Résistance et revenus dans leurs rangs bien renseignés, que
les miliciens mettent sur pied l’investissement de villages entiers. Nous
illustrerons ceci par quelques exemples.
Lorsque des agents de la Gestapo et des Miliciens investissent Nyons le 21 janvier 1944, ils arrêtent 8 résistants locaux, dont six mourront en déportation. À Taulignan, ce sont les miliciens de Montélimar qui, le 9 février 1944, arrêtent et conduisent à la Gestapo M. et Mme Gras, Marc dit la Cloche, le gendarme Chalou et l'ouvrier agricole Guitton qui, sauf ce dernier, seront torturés et déportés. Ce sont encore ces miliciens montiliens qui arrêtent le 21 février Suzanne Dupont et Mathilde Bravais.
Le 22 février 1944 à Izon-la-Bruisse, dont l’école servait de logement à 250 FFI (Forces françaises de l’intérieur) du maquis Ventoux, 35 hommes sont lâchement fusillés 4 par 4 après avoir été fouillés et dépouillés.
Chez le boucher Faure de Montoison, des miliciens viennent perquisitionner le 8 mars 1944. À défaut de le saisir avec sa femme, ils arrêtent son commis. Marius Sapin qui est déporté.
Le 14 mars, la Milice arrête des membres du groupe Tain-Tournon : Étienne Morand, les frères Louis et Gaston Pinet, Marcel Billon, et Georges Girard qu'ils hébergeaient chez eux après qu'il eût tué un responsable de la Gestapo de Lyon. Emmenés à Lyon, Girard est fusillé, les autres déportés.
Le 19 mars 1944 à 7 h, à Nyons, une trentaine de soldats allemands accompagnés de 3 miliciens en uniformes des Chantiers de jeunesse cernent la maison du docteur Jean Bourdongle qui est arrêté et conduit dans la salle des mariages de la mairie. Il sera fusillé à Condorcet (Saint-Pons). Paul Bernard, maçon à Nyons, est arrêté le 21 mars par des miliciens et remis aux Allemands qui le déportent à Dachau. Le 16 avril, la Milice arrête à Romans Ernest Diébold, réfugié lorrain, et Pierre Revol. Ils sont déportés en Allemagne. Diebold ne reviendra pas. Fernand Chauffingeal, arrêté à Malissard le 17 avril, mourra en déportation. André Giroud est arrêté et torturé à Saint-Nazaire-en-Royans. Le lendemain, les miliciens arrêtent l'instituteur Louis Ferroul, l'emmènent à Valence puis à Lyon où il est interné.
Le 8 juin, aux Crozes commune de Peyrins, deux miliciens du lieu, les frères D., ont aperçu des résistants en embuscade dans leur voisinage : ils se précipitent à bicyclette à Romans pour prévenir les Allemands. Une équipe de la compagnie Bozambo tente d'arrêter les deux frères. L'un d'eux est tué, l’autre réussit à s'échapper. À proximité, un groupe de résistants est intercepté par des miliciens et des Allemands. Deux d'entre eux sont tués, les autres, blessés, restent à râler dans un fossé, gardés par la Milice. Le lendemain, trois rescapés transportés à la caserne Bon, à Romans, par les miliciens, sont interrogés par neuf Français de la Gestapo de Lyon et un Allemand. Deux sont achevés le lendemain.
Le 12 juillet, au retour d'un sabotage, une équipe de la compagnie Mabboux veut intercepter une voiture de miliciens et les prendre vivants. Après une poursuite, les miliciens s’arrêtent au Creux-de-la-Thine et ouvrent le feu à la mitraillette sur les Résistants, faisant 2 morts et 3 blessés. Le sous-lieutenant Vibout est abattu au volant de sa voiture, son voisin également. Leurs corps sont poussés dans le fossé avec ceux de deux blessés. Pollet réussit à s'enfuir soutenant son bras ensanglanté.
Lors de l’occupation de Die par les Allemands à partir du 22 juillet 1944, la Milice est à leurs côtés et leur chef, le traître Halperson, le dentiste de la Motte-Chalencon vêtu en officier allemand, joue les premiers rôles. À leur arrivée à Die, Allemands et miliciens ont tout de suite cherché Camille Buffardel, Auguste Werly et Léon Livache, dénoncés par Halperson. Ils se précipitent dans les hôtels et à l’hôpital où ils arrêtent Cohen, Feldman, Froment, Jeanneret, Lieber, le Juif Albert Peters, ancien artiste lyrique et chef d'orchestre à Berlin, qu’ils massacrent à la prison ainsi que 4 jeunes gens pris à Romeyer : Gagnole, Ordassière, Canovas, Pedoyat. L’un d’eux n’étant pas mort sur le coup, un milicien s’acharne sur le corps en criant « tu ne veux pas mourir, sale Espagnol! ». Ce sont les miliciens qui pillent la maison du pasteur Loux, qui a été dénoncé, puis les caves de clairette Buffardel. Ce sont les miliciens qui remplacent au fronton de la mairie le sigle : Liberté, Égalité, Fraternité, par : Travail, Famille, Patrie. Ce sont les miliciens qui débaptisent la place de la République pour lui donner le nom de « place Philippe Henriot ». C’est le milicien ardéchois François qui harangue la foule parquée sur la place de l’Évêché : « je suis un bon Français... je ne suis pas pour les Allemands, je suis avec les Allemands, contre les Juifs, les communistes, les terroristes ». Ce sont les miliciens qui martyrisent Rousset, blessé de la Résistance, abattu quelques heures plus tard. Ce sont les miliciens qui s’emparent des sœurs de l’hôpital soumises à interrogatoire, après un simulacre d’exécution, puis enfermées. Ce sont les miliciens qui, le 23, exécutent Camille Buffardel, adjoint au maire, membre du Comité local de Libération, sur la place Saint-Pierre. Puis ce sera le tour de Vermorel, Laheurte, Plumel, Brugier, Basset, Livache, du docteur Kroll et de son fils. Le corps de Léon Livache, resté sur la route de Romeyer, sera écrasé par plusieurs véhicules allemands.
Le 25 juillet, à Recoubeau, une centaine d’Allemands, accompagnés de miliciens dirigés par Halperson, incendient la maison du père du lieutenant Bernard, puis le moulin de la famille Abonnenc à Luc-en-Diois. On les retrouve ensemble le 5 août à Vercheny, où ils tentent d’arrêter l’épouse du capitaine Pons qui réussit à leur échapper.
Dans l'après-midi du 23 août, des Allemands capturent Georges Bert de Saint-Donat : le commandant de la garnison de Tain le livre à la Milice. Il est assassiné par le milicien C.
Le 10 août 1944 vers 13 h 45, des maquisards du maquis Félines venant de Bourdeaux arrivent au village de Montboucher-sur-Jabron pour surprendre, au moment de sa sieste, le milicien valentinois Croze en permission dans une ferme. Ils le tuent d’une rafale de mitraillette. À 16 h 30, 50 Allemands et des miliciens viennent de Montélimar à Montboucher en expédition punitive, encadrés par la Gestapo. Ils prennent des otages : Léon Demauve et son père Gabriel. Des camions déménagent le mobilier et les bêtes. Entre 17 h 30 et 18 h, le père et le fils Demauve, attachés l’un à l’autre, sont arrosés d’essence et brûlent dans l’incendie de leur maison. Toute la nuit, des avions survolent la maison en flammes pour empêcher qu’on éteigne le feu. Le lendemain, on retrouve les restes des deux hommes, avec la chaîne noircie qui avait servi à les enchaîner. Leurs noms figuraient sur une liste de suspects aux mains de la Milice. Le lendemain, un barrage routier a été mis en place par les Allemands et miliciens. Vers 10 h, une voiture montée par deux jeunes hommes du bataillon Morvan non armés est interceptée, L’un d’eux réussit à disparaître, mais Albert Aurel est conduit dans le village et massacré à l’endroit où le milicien Croze avait été abattu la veille. Le 12 août, la population du village doit assister à ses obsèques, les bras obligatoirement chargés de fleurs. Le même soir, les maquisards incendient la ferme du milicien Garayt. En représailles, les miliciens arrêtent Rouvière, qui parvient à s’échapper, et Reboulet, torturé et tué. On retrouvera son corps affreusement mutilé. Le milicien Garayt sera passé par les armes trois jours après.
Robert Serre
http://www.museedelaresistanceenligne.org/pageDoc/pageDoc.php?id_expo=2&id_theme=6&id_stheme=26&id_sstheme=124&id_media=466&ordre_media=4#media
Lorsque des agents de la Gestapo et des Miliciens investissent Nyons le 21 janvier 1944, ils arrêtent 8 résistants locaux, dont six mourront en déportation. À Taulignan, ce sont les miliciens de Montélimar qui, le 9 février 1944, arrêtent et conduisent à la Gestapo M. et Mme Gras, Marc dit la Cloche, le gendarme Chalou et l'ouvrier agricole Guitton qui, sauf ce dernier, seront torturés et déportés. Ce sont encore ces miliciens montiliens qui arrêtent le 21 février Suzanne Dupont et Mathilde Bravais.
Le 22 février 1944 à Izon-la-Bruisse, dont l’école servait de logement à 250 FFI (Forces françaises de l’intérieur) du maquis Ventoux, 35 hommes sont lâchement fusillés 4 par 4 après avoir été fouillés et dépouillés.
Chez le boucher Faure de Montoison, des miliciens viennent perquisitionner le 8 mars 1944. À défaut de le saisir avec sa femme, ils arrêtent son commis. Marius Sapin qui est déporté.
Le 14 mars, la Milice arrête des membres du groupe Tain-Tournon : Étienne Morand, les frères Louis et Gaston Pinet, Marcel Billon, et Georges Girard qu'ils hébergeaient chez eux après qu'il eût tué un responsable de la Gestapo de Lyon. Emmenés à Lyon, Girard est fusillé, les autres déportés.
Le 19 mars 1944 à 7 h, à Nyons, une trentaine de soldats allemands accompagnés de 3 miliciens en uniformes des Chantiers de jeunesse cernent la maison du docteur Jean Bourdongle qui est arrêté et conduit dans la salle des mariages de la mairie. Il sera fusillé à Condorcet (Saint-Pons). Paul Bernard, maçon à Nyons, est arrêté le 21 mars par des miliciens et remis aux Allemands qui le déportent à Dachau. Le 16 avril, la Milice arrête à Romans Ernest Diébold, réfugié lorrain, et Pierre Revol. Ils sont déportés en Allemagne. Diebold ne reviendra pas. Fernand Chauffingeal, arrêté à Malissard le 17 avril, mourra en déportation. André Giroud est arrêté et torturé à Saint-Nazaire-en-Royans. Le lendemain, les miliciens arrêtent l'instituteur Louis Ferroul, l'emmènent à Valence puis à Lyon où il est interné.
Le 8 juin, aux Crozes commune de Peyrins, deux miliciens du lieu, les frères D., ont aperçu des résistants en embuscade dans leur voisinage : ils se précipitent à bicyclette à Romans pour prévenir les Allemands. Une équipe de la compagnie Bozambo tente d'arrêter les deux frères. L'un d'eux est tué, l’autre réussit à s'échapper. À proximité, un groupe de résistants est intercepté par des miliciens et des Allemands. Deux d'entre eux sont tués, les autres, blessés, restent à râler dans un fossé, gardés par la Milice. Le lendemain, trois rescapés transportés à la caserne Bon, à Romans, par les miliciens, sont interrogés par neuf Français de la Gestapo de Lyon et un Allemand. Deux sont achevés le lendemain.
Le 12 juillet, au retour d'un sabotage, une équipe de la compagnie Mabboux veut intercepter une voiture de miliciens et les prendre vivants. Après une poursuite, les miliciens s’arrêtent au Creux-de-la-Thine et ouvrent le feu à la mitraillette sur les Résistants, faisant 2 morts et 3 blessés. Le sous-lieutenant Vibout est abattu au volant de sa voiture, son voisin également. Leurs corps sont poussés dans le fossé avec ceux de deux blessés. Pollet réussit à s'enfuir soutenant son bras ensanglanté.
Lors de l’occupation de Die par les Allemands à partir du 22 juillet 1944, la Milice est à leurs côtés et leur chef, le traître Halperson, le dentiste de la Motte-Chalencon vêtu en officier allemand, joue les premiers rôles. À leur arrivée à Die, Allemands et miliciens ont tout de suite cherché Camille Buffardel, Auguste Werly et Léon Livache, dénoncés par Halperson. Ils se précipitent dans les hôtels et à l’hôpital où ils arrêtent Cohen, Feldman, Froment, Jeanneret, Lieber, le Juif Albert Peters, ancien artiste lyrique et chef d'orchestre à Berlin, qu’ils massacrent à la prison ainsi que 4 jeunes gens pris à Romeyer : Gagnole, Ordassière, Canovas, Pedoyat. L’un d’eux n’étant pas mort sur le coup, un milicien s’acharne sur le corps en criant « tu ne veux pas mourir, sale Espagnol! ». Ce sont les miliciens qui pillent la maison du pasteur Loux, qui a été dénoncé, puis les caves de clairette Buffardel. Ce sont les miliciens qui remplacent au fronton de la mairie le sigle : Liberté, Égalité, Fraternité, par : Travail, Famille, Patrie. Ce sont les miliciens qui débaptisent la place de la République pour lui donner le nom de « place Philippe Henriot ». C’est le milicien ardéchois François qui harangue la foule parquée sur la place de l’Évêché : « je suis un bon Français... je ne suis pas pour les Allemands, je suis avec les Allemands, contre les Juifs, les communistes, les terroristes ». Ce sont les miliciens qui martyrisent Rousset, blessé de la Résistance, abattu quelques heures plus tard. Ce sont les miliciens qui s’emparent des sœurs de l’hôpital soumises à interrogatoire, après un simulacre d’exécution, puis enfermées. Ce sont les miliciens qui, le 23, exécutent Camille Buffardel, adjoint au maire, membre du Comité local de Libération, sur la place Saint-Pierre. Puis ce sera le tour de Vermorel, Laheurte, Plumel, Brugier, Basset, Livache, du docteur Kroll et de son fils. Le corps de Léon Livache, resté sur la route de Romeyer, sera écrasé par plusieurs véhicules allemands.
Le 25 juillet, à Recoubeau, une centaine d’Allemands, accompagnés de miliciens dirigés par Halperson, incendient la maison du père du lieutenant Bernard, puis le moulin de la famille Abonnenc à Luc-en-Diois. On les retrouve ensemble le 5 août à Vercheny, où ils tentent d’arrêter l’épouse du capitaine Pons qui réussit à leur échapper.
Dans l'après-midi du 23 août, des Allemands capturent Georges Bert de Saint-Donat : le commandant de la garnison de Tain le livre à la Milice. Il est assassiné par le milicien C.
Le 10 août 1944 vers 13 h 45, des maquisards du maquis Félines venant de Bourdeaux arrivent au village de Montboucher-sur-Jabron pour surprendre, au moment de sa sieste, le milicien valentinois Croze en permission dans une ferme. Ils le tuent d’une rafale de mitraillette. À 16 h 30, 50 Allemands et des miliciens viennent de Montélimar à Montboucher en expédition punitive, encadrés par la Gestapo. Ils prennent des otages : Léon Demauve et son père Gabriel. Des camions déménagent le mobilier et les bêtes. Entre 17 h 30 et 18 h, le père et le fils Demauve, attachés l’un à l’autre, sont arrosés d’essence et brûlent dans l’incendie de leur maison. Toute la nuit, des avions survolent la maison en flammes pour empêcher qu’on éteigne le feu. Le lendemain, on retrouve les restes des deux hommes, avec la chaîne noircie qui avait servi à les enchaîner. Leurs noms figuraient sur une liste de suspects aux mains de la Milice. Le lendemain, un barrage routier a été mis en place par les Allemands et miliciens. Vers 10 h, une voiture montée par deux jeunes hommes du bataillon Morvan non armés est interceptée, L’un d’eux réussit à disparaître, mais Albert Aurel est conduit dans le village et massacré à l’endroit où le milicien Croze avait été abattu la veille. Le 12 août, la population du village doit assister à ses obsèques, les bras obligatoirement chargés de fleurs. Le même soir, les maquisards incendient la ferme du milicien Garayt. En représailles, les miliciens arrêtent Rouvière, qui parvient à s’échapper, et Reboulet, torturé et tué. On retrouvera son corps affreusement mutilé. Le milicien Garayt sera passé par les armes trois jours après.
Robert Serre
http://www.museedelaresistanceenligne.org/pageDoc/pageDoc.php?id_expo=2&id_theme=6&id_stheme=26&id_sstheme=124&id_media=466&ordre_media=4#media